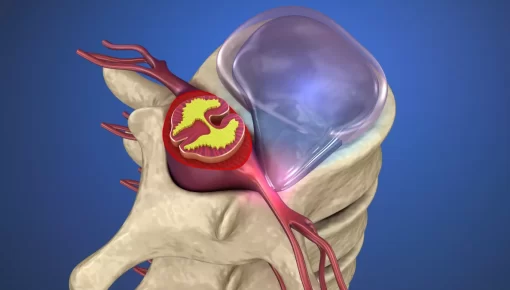Les victimes de violences sexuelles sortent parfois du silence des années après les faits, au point qu’il arrive que le délai de prescription soit dépassé. Ces témoignages sur le tard font régulièrement polémique, mais trouvent leur explication dans des mécanismes psychiques et psychologiques.
L’exemple le plus récent de la remise en question d’un témoignage sur des violences sexuelles remonte à quelques jours seulement. Sur RTL, samedi 10 février, Anny Duperey assure se méfier des « chasses aux sorcières tardives ». Prise de parole en réaction au témoignage de Judith Godrèche deux jours plus tôt, sur France Inter, après avoir porté plainte pour viols sur mineure contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon.
Les faits remontent à la fin des années 80, Judith Godrèche a 14 ans quand elle entretient une relation avec Benoît Jacquot, 40 ans à l’époque. Six ans « d’emprise », dénonce l’actrice, qui explique avoir croisé le chemin de Jacques Doillon sur le tournage d’un film à la même période. Tournage pendant lequel elle l’accuse, lui aussi, de violences sexuelles.
Plus de 30 ans se sont écoulés depuis, et c’est à l’occasion de la sortie de sa série Icon of French Cinema, diffusée sur Arte fin 2023, que Judith Godrèche a choisi de s’exprimer.
Dans la foulée de son témoignage, d’autres actrices, parmi lesquelles Anna Mouglalis, ont dénoncé le comportement de Jacques Doillon. Depuis son intervention sur RTL, Anny Duperey a présenté ses excuses à Judith Godrèche, mardi 13 février, dans le média Simone. « Je le sais d’expérience, il faut parfois très longtemps pour exprimer un traumatisme », a ajouté l’actrice.
Des témoignages en entraînant d’autres, plusieurs dizaines d’années après les faits : un phénomène déjà observé dans l’actualité, notamment depuis le début du mouvement #Metoo. Un phénomène qui trouve des explications psychiques, psychologiques et sociales.
La levée de l’amnésie traumatique
Pour dénoncer des faits, il faut mettre des mots dessus, s’en souvenir, les appréhender, les formuler. L’étape du souvenir est cruciale quand on sait que les traumatismes les plus violents sont souvent effacés de la conscience par ce qu’on appelle l’amnésie traumatique.
Anaïs Vois est psychologue spécialiste des violences sexistes et sexuelles : « Quand il vit un événement traumatique qui entraîne une situation de sidération, d’impuissance, l’individu n’est pas en capacité d’activer les réseaux mnésiques habituels dont on fait tous usage pendant que les choses vont relativement bien, explique-t-elle. Cette violence que l’individu subit, peut, mais ce n’est pas systématiquement le cas, à un moment être refoulée parce qu’insupportable à garder dans la conscience pour poursuivre sa vie telle qu’elle est. »
C’est fréquemment le cas dans les violences sexuelles intrafamiliales durant l’enfance : « Comment continuer à exister au sein de la famille dont j’ai besoin, qui me rassure, qui me permet de me construire tout en intégrant ma conception consciente de l’existence, que mon père est un violeur ? Les rapports sont extrêmement complexes et ambivalents. »
Cette amnésie traumatique peut être totale ou partielle et soudainement levée plus tardivement, parfois vingt, trente ou quarante ans plus tard : « Il y a des moments où l’espace psychique est prêt à accueillir cet événement dans son histoire. Il y a quelque chose qui permet ça. Ça peut être déclenché par un événement, ça peut être aussi un moment juste où c’est possible pour l’individu d’intégrer ce qu’il a dû subir, ce à quoi il a pu être confronté, sans que ce soit trop déstructurant. »
L’évolution des mœurs dans la société
L’évolution des mœurs, les changements de mentalité au fil du temps, permettent parfois à certaines victimes de reconsidérer une situation passée. Salomé Sperber est psychocriminologue : « Il y a vraiment une évolution dans les limites de soi, dans les limites de l’autre, dans ce qui peut être autorisé et ce qui ne l’est pas.
Mais aussi dans les définitions de la violence au sens très large du terme. Maintenant, on entend beaucoup parler du ‘continuum de la violence’ et ça nous permet de revenir questionner certains éléments qui étaient totalement banalisés. »
Cette évolution de la société va de pair avec la création d’un espace de parole : « Des choses qui, à l’époque, étaient totalement passées sous silence pourraient maintenant peut-être trouver un peu de résonance du fait qu’on s’est autorisé à en parler, notamment avec le mouvement #Metoo. Donc oui, les choses évoluent et peut-être qu’on arrive à raccrocher des wagons qui nous permettent d’avoir une lecture systémique alors qu’avant on voyait plutôt des épiphénomènes. »
Pour trouver la force de témoigner ou de se confier, publiquement ou à des proches dans la sphère privée, il faut que la victime soit assurée que sa parole puisse être accueillie, qu’elle soit crue, sans jugement.
À ce sujet, Salomé Sperber tient à lever un préjugé sur le profil des agresseurs.
La plupart des violences sexuelles sont commises par des personnes qui font partie de l’entourage des victimes : « Ce qu’il faut garder en tête, c’est qu’on n’est pas forcément face à des gens qui sont fous ou monstrueux. C’est quelque chose qui revient assez régulièrement pour qualifier les agresseurs qui passent à l’acte. C’est souvent un peu ce qu’on appelle le syndrome du voisin d’à côté. » La société a souvent du mal à croire, à accepter que des personnes en apparence « normale » puissent commettre de tels actes.
La libération de l’espace de parole est aussi une manière d’expliquer les témoignages en cascade qui peuvent parfois émerger : « Le fait d’entendre potentiellement que quelqu’un a vécu la même chose que soi, ça permet une légitimité. » D’où l’effet particulièrement vertueux de la création de la Ciase et de la Ciivise, insiste Salomé Sperber : « Ça a pu donner le petit coup de pouce qui parfois manquait à la personne qui se disait ‘J’ai peur de ne pas être crue ou entendue.’
De savoir qu’il y a des personnes qui ont vécu la même chose, potentiellement avec le même agresseur – ou pas – ça peut rassurer. »
Les victimes qui se reconnaissent tardivement sont aussi parfois rattrapées par un aspect protecteur d’autres potentielles victimes : « Pour qu’il n’y ait plus personne qui en soit victime. Donc le fait d’avoir potentiellement plusieurs personnes victimes d’un même agresseur ou d’une même agresseuse peut permettre de lever plus facilement la parole. »
Dans une lettre ouverte publié dans Le Monde et adressée à sa fille aujourd’hui âgée de 18 ans, Judith Godrèche explique cette prise de parole : « Il n’y a pas si longtemps, tu avais quinze ans. Il n’y a pas si longtemps, je taisais mon histoire », dit-elle. Ajoutant : « Je comprends qu’il est temps de raconter mon histoire. Pour vous, pour toutes celles et ceux qui vivent encore dans un silence imposé. »
La sortie de l’état d’emprise
Pour pouvoir se considérer comme victime d’un agresseur, il est essentiel que la victime ne soit plus sous l’emprise de son bourreau : « L’aboutissement de la mise sous emprise, explique Salomé Sperber, c’est une espèce de reprogrammation, c’est comme si on venait changer le système d’exploitation d’un ordinateur. Donc la personne qui va être sous emprise va être parasitée, reprogrammée par la personne qui met sous emprise. »
La sortie de l’emprise est un cheminement parfois long à réaliser, qui ne peut se faire que dans le respect du rythme de la victime, explique la psychocriminologue : « L’un des mécanismes de l’emprise, ça va être de maintenir une espèce de flou artistique qui fait que la personne va finir par douter de ses propres pensées, de ses propres souvenirs, en disant ‘Est-ce que ça s’est vraiment passé ?
Est-ce que j’ai raison de l’interpréter comme quelque chose de violent ou pas, ou comme quelque chose de problématique ?
La sortie d’une relation d’emprise nécessite de remettre du sens, remettre ses propres limites en tant qu’individu, qui ont été totalement détruites. » Il faut pour cela « déconstruire ce qui a pu être un peu inséré au forceps. » Un processus qui nécessite une prise en charge, précise Salomé Sperber, si la personne concernée en ressent le besoin.
franceinfo