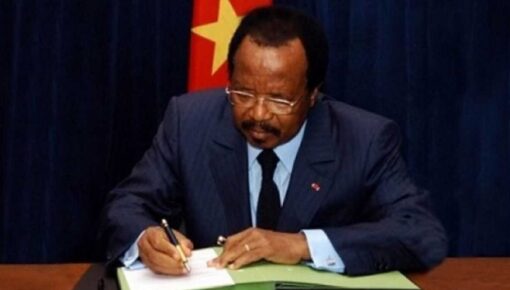Le collectif Investigative Journalism Reportika vient de publier une étude intitulée « What’s Wrong with the Reports ? » sur les classements mondiaux qui, chaque année, notent les pays selon leur niveau de corruption, de liberté d’expression, de qualité de gouvernance ou encore de bonheur.
Selon les auteurs, tous ces rapports ont en commun de souffrir de biais et de lacunes méthodologiques. Plusieurs classements, notamment le World Press Freedom Index de RSF, le Corruption Perceptions Index de Transparency, ou encore le World Happiness Report, reposent en grande partie sur des enquêtes d’opinion ou des perceptions subjectives et partielles, ce qui introduit des biais culturels, personnels ou médiatiques.
La plupart de ces notations ont également en commun d’utiliser des méthodologies universelles qui ne tiennent pas compte des contextes locaux, comme les différences culturelles, sociales, économiques ou politiques.
Dans le World Press Freedom Index, publié par Reporters sans Frontières, une part importante du score de chaque pays repose sur des réponses qualitatives à des questionnaires soumis à des experts et journalistes sélectionnés. Les scores sont ainsi « influencés par les perceptions des répondants, plus que par des données objectives », estime Reportika.
Le collectif de journalistes regrette une certaine opacité sur les critères utilisés, autant pour noter les pays que pour sélectionner les répondants.
L’étude souligne également que l’évaluation des pays élude certains critères majeurs comme la qualité du journalisme, la densité du paysage médiatique ou les conditions de travail des journalistes.
Il souligne par exemple que le classement 2024 place l’Inde au 159e rang, derrière le Pakistan qui se situe à la 152e place.
Et pourtant, soulignent les auteurs, « le paysage médiatique de l’Inde est l’un des plus vastes et des plus diversifiés au monde », avec des journalistes de bon niveau, alors que le Pakistan impose à un parc médiatique plus modeste « des limites très strictes et des pressions permanentes de la part du gouvernement et de l’armée », sans commune mesure avec les interférences du pouvoir indien.
Pour ce qui concerne le Corruption Perceptions Index de Transparency International, il repose principalement sur des évaluations d’experts et des enquêtes auprès de « leaders d’opinion », ce qui reflète des perceptions subjectives plutôt que des faits vérifiables. Les réponses sont ainsi influencées par la couverture médiatique ou à la réputation des pays, voire par des événements récents fortement médiatisés. Les auteurs soulignent ainsi des incohérences telles que certains pays africains qui luttent activement contre la corruption, classés moins bien que la Chine.
Ils déplorent également une standardisation des critères qui élude les spécificités culturelles, les systèmes juridiques différents ou les contextes sociaux.
Pour les auteurs, les données utilisées proviennent souvent d’experts ou de chefs d’entreprise qui ignorent les expériences des citoyens ordinaires confrontés quotidiennement à la corruption, notamment dans les services publics.
Enfin, l’Index n’évalue pas les mécanismes structurels qui permettent de lutter contre la corruption, tels que les réformes législatives ou les institutions anti-corruption. « Cette approche simpliste peut donner l’impression que certains pays ne progressent pas, même lorsqu’ils mettent en œuvre des efforts significatifs », juge l’étude.
Parmi les exemples cités, on trouve le Vietnam à égalité avec l’Afrique du Sud, au 83e rang : « Le Vietnam est gouverné par un contrôle étatique important, ce qui permet une corruption persistante et de haut niveau qui passe souvent inaperçue. L’Afrique du Sud, également classée 83e avec le même score, est une nation démocratique où la corruption est fréquemment révélée par une presse libre, et où les efforts en faveur de la transparence sont réels.
Le classement égal minimise les mesures institutionnelles de l’Afrique du Sud contre la corruption, qui contrastent avec les campagnes anti-corruption centralisées et politiquement orientées du Vietnam. »
Les auteurs citent également la Russie placée au même niveau que l’Ouganda, au 141e rang.
« La Russie est confrontée à une corruption systémique ancrée aux plus hauts niveaux du gouvernement, avec un contrôle centralisé permettant une corruption généralisée. La corruption en Ouganda, bien que répandue, est généralement localisée au sein de sa bureaucratie et n’a ni l’ampleur, ni l’organisation observées en Russie. Le score similaire ne reflète pas ces dynamiques de corruption contrastées, qui varient considérablement en termes de portée et d’influence selon leurs systèmes politiques. »
Le World Happiness Report est également critiqué pour sa dépendance aux perceptions subjectives, ses biais en faveur des pays développés, son incapacité à refléter les inégalités locales, et sa définition restrictive du bonheur qui ne prend pas en compte les différences culturelles.
Selon les auteurs, le concept de « bonheur » peut varier considérablement d’une culture à l’autre, et le rapport n’intègre pas suffisamment ces différences. Par exemple, dans certaines cultures, le bonheur est davantage perçu comme un état collectif ou spirituel plutôt qu’individuel, ce qui complique l’utilisation d’une échelle universelle.
Enfin, Reportika cite quelques exemples d’incohérences tels que la dictature militaire du Myanmar plus heureuse que l’Inde ou encore la Palestine plus heureuse que le Sri Lanka.
L’étude de Reportika passe également au crible d’autres classements tels que le Global Hunger Index ou le Global Corruption Barometer. La mention « Part I » accolée au titre suggère qu’un second tome serait en préparation.
ecofin