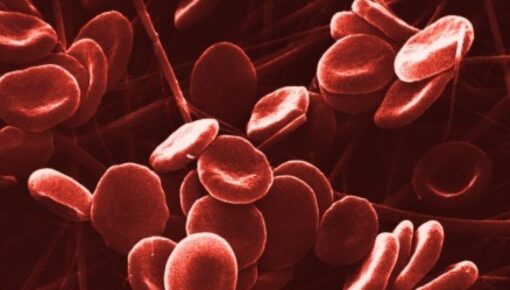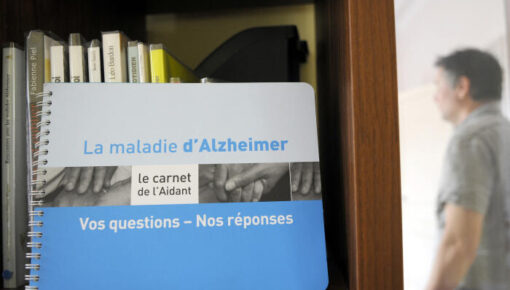Depuis 2019, l’idée de mettre en place en France une sécurité sociale de l’alimentation a émergé de manière structurée. Ce projet vise, d’une part, à mettre en œuvre le droit à l’alimentation — et donc à mettre fin au système jugé indigne de l’aide alimentaire — et, d’autre part, à favoriser une transition des filières alimentaires vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement et de leurs acteurs. Pour comprendre ce concept, nous avons interviewé Tanguy Martin, coauteur avec Sarah Cohen d’un ouvrage qui en expose les fondements.
Sciences et Avenir : Dans votre livre « De la démocratie dans nos assiettes », vous partez d’un premier constat, l’existence d’une insécurité alimentaire structurelle en France. Qu’entendez-vous par là ?
Tanguy Martin : Le concept d’insécurité alimentaire, bien que développé initialement pour les pays du Sud, a été adopté et adapté dans les pays industrialisés. Dans les pays dits à faibles revenus, l’insécurité alimentaire mesure principalement la capacité de ces pays à nourrir leur population grâce à leur production agricole. En revanche, dans les pays considérés comme plus riches, l’accent est mis sur la perception des individus concernant leur accès à une nourriture suffisante et de qualité.
Néanmoins, la définition de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), qui s’applique à toutes les zones géographiques du globe, indique bien que l’insécurité alimentaire concerne aussi bien les dimensions quantitatives que qualitatives de l’alimentation.
« La proportion de Français ne mangeant pas à leur faim est passée de 12 % à 16 % entre juillet et novembre 2022 »
En France, cette notion a été intégrée en 2006-2007 aux études INCA, qui examinent régulièrement les comportements alimentaires des Français. Ainsi, l’enquête INCA 3, publiée en 2017, a révélé que plus de 7 millions de personnes étaient en situation d’insécurité alimentaire, avant même les impacts de la crise sanitaire et de l’inflation récente. Ces résultats ont depuis été confirmés par d’autres travaux comme le Baromètre Ipsos/Secours populaire français de 2023 ou une étude récente du Credoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie), qui a notamment documenté l’aggravation de cette situation.
Selon cette dernière publication, entre juillet et novembre 2022, la proportion de Français ne mangeant pas à leur faim est passée de 12 % à 16 %.
De même, en 2016, la moitié des Français déclaraient pouvoir manger tous les aliments qu’ils souhaitaient, mais ce chiffre est tombé à seulement un tiers en 2022. Cela reflète non seulement une insuffisance alimentaire quantitative (ne pas avoir assez à manger) mais aussi qualitative (ne pas pouvoir se permettre les aliments de son choix). Nous sommes donc bien face à une insécurité alimentaire structurelle en France.
Comment se nourrissent ces personnes ?
En 2019 , environ 5,5 millions de personnes survivaient en recourant à l’aide alimentaire en France, selon la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Depuis, ces chiffres ont encore progressé : une enquête menée au printemps 2021 (par l’Insee et la DREES) révélait qu’une majorité des centres de distribution d’aide alimentaire ont constaté une augmentation importante de leur fréquentation. On se souvient, à l’automne dernier, du cri d’alarme de Jean-Yves Troy, délégué général des Restos du Cœur : « Les Restos du Cœur ne sont pas dimensionnés aujourd’hui pour distribuer 170 millions de repas, et pour accueillir 1,3 million de personnes. »
Quel est le coût du financement de l’aide alimentaire en France
Un rapport du Sénat de 2018 a évalué le coût de l’aide alimentaire à 1,5 milliard d’euros répartis de la façon suivante :
– 31 % de financements publics (aides européennes, dépenses budgétaires de l’État et des collectivités territoriales, dépenses fiscales) ;
– 36 % de financements privés (dons en nature et numéraires des particuliers et entreprises) ;
– 33 % correspondant à la valorisation du bénévolat au sein des associations intervenant dans le domaine de l’aide alimentaire.
Comment en sommes-nous arrivés à une telle situation ?
Reprenons l’exemple des Restos du Cœur. En 1985, face à l’augmentation de la pauvreté en France, Coluche avait proposé d’utiliser les stocks conservés par la Communauté européenne, les excédents des restaurants et des supermarchés afin de venir en aide aux plus démunis.
Initialement conçue comme une mesure humanitaire transitoire, similaire à celles mises en place dans les pays touchés par des catastrophes climatiques ou des conflits, cette aide s’est pérennisée et s’est structurée devant l’incapacité des pouvoirs publics à imaginer d’autres solutions : si en 1985-1986, l’association de l’humoriste distribuait 8,5 millions de repas avec l’aide de 5000 bénévoles, en 2017 c’est pas moins de 130 millions de repas qui ont été distribués par plus de 72.000 bénévoles.
Pourtant, la France n’est pas en guerre, elle est même la première puissance agricole européenne et est un pays très attaché à sa culture gastronomique. L’ONU nous a d’ailleurs interpellé sur notre incapacité à mettre fin à ce système de charité structuré et à élaborer une véritable politique alimentaire.
« Depuis la loi de 2016, les supermarchés se débarrassent des invendus en échange d’une réduction d’impôts »
Vous dites même que l’État et l’Union européenne encourage ce système ?
Pour comprendre, il faut savoir que les quatre principales associations habilitées à distribuer de l’aide alimentaire (Les Restos du Cœur, les Banques Alimentaires, le Secours Populaire et la Croix-Rouge) n’arrivent pas à nourrir les demandeurs avec les grandes collectes d’aliments réalisées auprès des particuliers, et les soutiens financiers.
Ainsi les deux principales sources d’aliments proviennent, d’une part, des invendus des enseignes alimentaires, et d’autre part, d’achats subventionnés par un programme européen : le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD).
Concernant la première source, une loi a encadré les dons des supermarchés en les défiscalisant. Pour être clair, depuis 2016 et la loi de Guillaume Garot, les supermarchés se débarrassent des invendus en échange d’une réduction d’impôts.
Ce que vous et moi n’avons pas acheté est donné aux plus pauvres, tout en permettant aux supermarchés de ne pas avoir à traiter leurs produits invendables et de s’acheter en plus une bonne image de marque auprès du grand public. Ainsi, ce sont les usagers de ces associations qui consomment ce qui est surproduit et qui contribuent à éviter le gaspillage alimentaire.
D’ailleurs, parler de don est une erreur, car leur défiscalisation coûte à l’État français pas moins de 360 millions d’euros par an, selon l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS). Ceux qui donnent vraiment sont surtout les bénévoles de ces associations qui offrent du temps et sont enrôlés malgré eux dans ce blanchiment social de la grande distribution.
Les invendus donnés aux associations par les supermarchés sont de plus en plus mauvaise qualité
Aujourd’hui, avec la multiplication des enseignes et des opérations et rayons « anti-gaspillage”, qui permettent à la grande distribution de revendre à coût très bas les produits arrivant à leur date limite de consommation, la qualité de ce que les bénévoles récupèrent lors de ce qu’ils appellent “la ramasse” s’est encore dégradée. Le taux de rebut correspondant aux dons des supermarchés non utilisables est passée de 8% en 2016 à près de 10% en 2019.
De plus, les produits collectés ne répondent pas toujours aux besoins réels des bénéficiaires, tant en matière d’équilibre alimentaire que de plaisir gustatif.
“Encore des patates !”, s’exclama pendant le confinement une personne bénéficiaire de l’aide alimentaire, car 500.000 tonnes de pommes de terre, initialement destinées à la restauration et aux collectivités, et sans preneurs par suite de la crise sanitaire, ont été déversées par la filière légumière dans les structures d’aide, avec avantages fiscaux à l’appui.
Avec les pommes de terre, il est encore possible de préparer un repas, mais avec des canettes de sodas, des chips saveur bolognaise, des yaourts soja, des chewing-gums, de la nourriture pour chat, ou un stock d’œufs Kinder série limitée Harry Potter, comme ont témoigné les bénévoles dans une enquête menée en février 2024 par nos confrères de 20 minutes, il est clair qu’il n’est plus question de nourriture.
C’est pourquoi, les associations appelaient dans ce reportage à davantage de contrôles de la part de la Répression des fraudes, car en donnant des produits non conformes, les supermarchés se livrent à un délit de fraude fiscale.
Quel est le rôle de l’Union européenne ?
L’Union européenne intervient à travers le Fonds européen d’aide aux plus démunis, une enveloppe budgétaire auquel l’État français participe à hauteur de 10% (un budget de 647 millions d’euros pour la période 2021-2027). Ces lignes budgétaires ont été mises en place quand Bruxelles a arrêté de stocker une partie de la production agricole pour garantir un prix aux agriculteurs. En effet, une part importante de ces stocks revenait aux associations.
Avec ces fonds, FranceAgriMer, un établissement public national, lance des appels d’offres auprès des sociétés agroalimentaires pour acheter des produits destinés aux associations.
Cependant, l’objectif de cette institution est d’obtenir le plus grand volume d’aliments au coût le plus bas possible, ce qui se fait malheureusement souvent au détriment de la qualité. On se souvient de l’affaire des 780 tonnes de steaks hachés achetés par FranceAgriMer. Cette viande était en réalité composée d’une mixture d’amidon, de soja, de peau et de gras.
En 2019, un rapport de l’IGAS, consacré à l’aide alimentaire, avait noté que “le mécanisme des appels d’offres par FranceAgriMer est inadapté à une gestion rigoureuse et ne favorise ni la qualité ni un contrôle sanitaire satisfaisant” des denrées destinées aux plus démunis.
Les inspectrices et inspecteurs avaient même précisé que ce type d’appel d’offres, exigeant des gros volumes et des capacités logistiques importantes, ne permettait pas à des agriculteurs de vendre par ce biais leurs productions. Ils avaient conclu que, remportés par de grosses industries agroalimentaires, ces marchés ne répondaient pas aux critères d’une alimentation de qualité fondée sur le “manger, mieux, local, sainement”, comme rappelé lors des États généraux de l’alimentation.
Finalement, dans ce système, les personnes en difficulté doivent accepter ce que d’autres ont choisi de leur donner à manger ?
Oui, la France pratique plutôt la charité, à l’image de ce qui se faisait en matière de santé au 19e siècle. Pourtant, il existe un droit à l’alimentation qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et est précisé par un autre texte (le Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux) ratifié par 171 pays, dont la France.
Ce droit peut être résumé comme le droit à un accès régulier, permanent et libre à une nourriture quantitativement et qualitativement suffisante correspondant aux traditions culturelles. Faire la queue pour aller récupérer ce que l’on a bien voulu mettre à votre disposition est bien éloigné du respect de ce droit élémentaire et est même une forme de violence exercée sur les plus faibles, comme l’a montré l’anthropologue Bénédicte Bonzi.
Un manque criant de fruits et légumes pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire
En France, deux études importantes (2004-2005 et 2011-2012), ont été réalisées pour évaluer les habitudes de consommation alimentaire et l’état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Ainsi, seuls 7,3 % des bénéficiaires des structures de distribution de denrées et 2,7 % des bénéficiaires des structures de distribution de repas consommaient des fruits et légumes cinq fois par jour ou plus. Environ 20 % des participants déclaraient ne pas manger de fruits et légumes tous les jours.
Concernant les produits sucrés, 26 % des participants rapportaient consommer des boissons sucrées quotidiennement.
Seuls 66,6 % des participants des structures de distribution de denrées et 50,2 % de ceux des structures de repas avaient pris un petit déjeuner le jour précédant l’enquête. Toutefois, entre les deux périodes des études, des améliorations ont été notées, notamment l’augmentation de la consommation de fruits et légumes et de produits de la pêche.
Malgré ces évolutions positives, les niveaux de consommation de certains groupes alimentaires, en particulier les fruits et légumes, restent extrêmement faibles, soulignant les défis persistants en matière de sécurité nutritionnelle parmi les bénéficiaires de l’aide alimentaire.
Évidemment cette consommation insuffisante de fruits et légumes n’est pas liée au fait que ces personnes ne souhaitent pas en manger mais parce qu’il y en a peu de distribués.
« Une carte vitale dotée d’un budget alimentaire mensuel et utilisable pour acheter des produits conventionnés »
Pour permettre aux plus démunis de gérer eux-mêmes leur budget alimentaire, ne serait-il pas pertinent de créer une allocation alimentaire similaire à l’allocation logement ?
A court terme, il est essentiel d’augmenter les minima sociaux pour permettre aux personnes aux plus faibles revenus de vivre dignement.
Cependant, on sait que pour ces personnes, le budget alimentaire est souvent une variable d’ajustement face à des dépenses incompressibles comme le loyer et le chauffage.
C’est pourquoi nous proposons de sanctuariser le budget alimentaire de tous les Français, à l’instar de ce qui est fait pour les dépenses de santé ou de retraite. Ce budget, qui serait géré sur le modèle de la Sécurité sociale — universel, solidaire et démocratique —, servirait également de levier pour faire évoluer notre système agricole.
Actuellement, 20% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté et l’agriculture émet 21% des gaz à effet de serre en France, principalement à cause de l’industrialisation de l’agriculture. C’est pourquoi nous proposons la mise en place d’une sécurité sociale de l’alimentation, qui pourrait soutenir à la fois les consommateurs et les producteurs dans une démarche durable.
Quels sont les grands principes de cette sécurité sociale de l’alimentation ?
Chaque Français disposerait d’une « carte vitale » dotée d’un budget alimentaire mensuel, que nous avons évalué en 2019 à 150 euros, utilisable pour acheter des produits conventionnés. Ces produits et leurs producteurs devraient répondre à un certain nombre de critères pour obtenir leur conventionnement dans des caisses locales…
Si ces caisses suivaient les aspirations des Français, le conventionnement devrait principalement concerner des denrées garantissant un revenu juste aux travailleurs (des agriculteurs aux caissières de supermarché, en passant par les ouvriers qui transforment notre alimentation) et qui ont le moins d’impact environnemental possible.
On peut établir une analogie avec les médicaments.
Pour qu’ils soient remboursés, leur efficacité réelle doit être démontrée et un prix est négocié entre l’Etat et l’industrie pharmaceutique. Il en irait de même pour les produits achetés avec la carte vitale de l’alimentation. L’objectif est de permettre aux gens de faire des choix sur ce qu’ils souhaitent réellement manger, et non pas se voir imposer les options de l’industrie agroalimentaire.
Comme je l’ai mentionné précédemment, un tiers des Français ne choisit pas ce qu’il mange, et cette situation est encore plus marquée pour les personnes en précarité alimentaire. Avec notre proposition, nous espérons contribuer à transformer notre modèle agroalimentaire en assurant une meilleure rémunération pour tous les acteurs de la filière, et en permettant à nos concitoyens de choisir librement leur alimentation.
Nous ne doutons pas que si nous dotons collectivement des moyens économiques nécessaires, nous choisirons collectivement une alimentation bien plus durable.
Quel serait le coût de cette mesure ?
Le coût de cette initiative est estimé à au moins 120 milliards d’euros. Pour le financer, il serait envisagé de s’appuyer sur les cotisations. Il ne s’agit pas de créer ex-nihilo une telle somme dans l’économie, mais de mieux répartir la valeur produite afin d’assurer un droit fondamental.
Quels que soient les détails techniques de la création de cette cotisation, une grande part des salariés verraient leurs revenus ainsi maintenus ou augmentés par un budget alimentation. De plus, un financement complémentaire serait nécessaire, notamment via la Politique agricole commune, pour permettre aux agriculteurs qui le souhaitent de modifier leurs pratiques sans que cela affecte négativement leurs revenus, et ce à grande échelle. Actuellement, la part consacrée à une agriculture « nourricière et durable » en France est absolument insuffisante pour alimenter l’ensemble de la population.
Il serait donc nécessaire de revoir certaines réductions d’impôts et de cotisations, comme le CICE, qui coûte 100 milliards d’euros par an à l’État et dont l’efficacité n’est pas à la hauteur de l’investissement.
Quant à la crainte que nous nous acheminions vers une orthorexie alimentaire, où tout le monde serait obligé de consommer la même chose, il n’en est rien. L’idée, comme dans les débuts de la Sécurité sociale, est qu’il y aurait des citoyens qui décideraient des produits à conventionner, à l’image de ce qui se fait pour les médicaments. Ensuite, libre à chacun de consommer des produits conventionnés ou non.
« Une expérimentation à Montpellier »
Y a-t-il des expérimentations en cours ?
L’une des expériences les plus avancées est, à ma connaissance, celle de Montpellier. 450 participants tirés au sort cotisent selon leurs moyens (de 1 à 150 euros ou plus) pour recevoir chacun 100 euros par mois.
Ces fonds, à dépenser uniquement dans des lieux de distribution alimentaire spécifiques tels que marchés paysans, épiceries bio et locales, sont gérés par une monnaie locale appelée la Mona. Un comité citoyen de cinquante membres gère cette caisse, décidant des montants des cotisations et des lieux de vente autorisés.
Cependant, ce projet est aujourd’hui largement subventionné (à hauteur de 400.000 euros). Pour équilibrer financièrement le système sans subventions, il serait nécessaire d’élargir l’expérimentation et son public. Il est en phase d’évaluation par des chercheurs et chercheuses pour déterminer son efficacité et les conditions de son extension à une plus large échelle.
C’est la seule?
Non, il y a aussi une expérimentation à Toulouse (Caissalim), ou encore en Gironde, en Alsace, à Cadenet dans le Vaucluse, à Tours, à Limoux, à Saint-Giroux en Ariège… Nous aimerions nous inspirer de l’histoire de la création de la Sécurité sociale en France. Avant son instauration officielle en 1946, de nombreuses caisses et mutuelles locales existaient à travers le pays. Ces expériences locales ont ensuite été consolidées pour former la sécurité sociale telle que nous la connaissons aujourd’hui.
sciencesetavenir